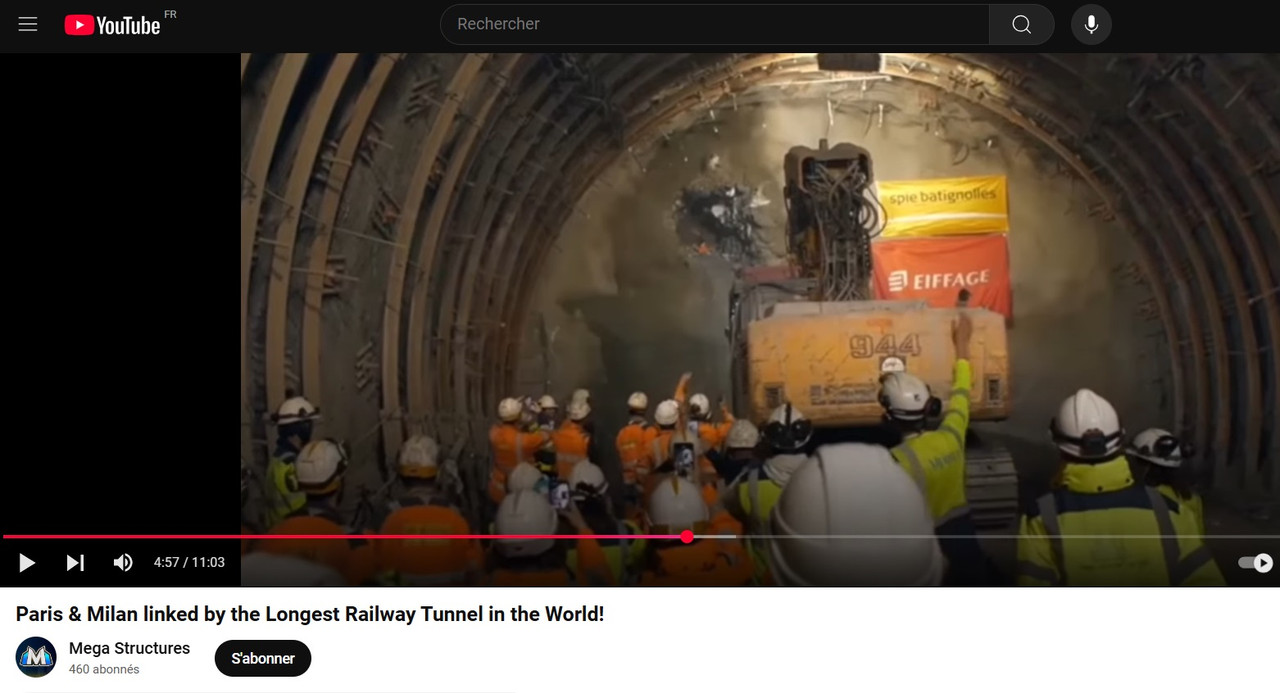LGV Lyon-Turin : la gestion des roches excavées reste un casse-tête
Emma RODOT Publié le 18/11/25
La société TELT, en charge du creusement du tunnel ferroviaire Lyon-Turin, vient d'inaugurer son centre de recyclage des terres excavées. Si la moitié des 24 millions de tonnes de roches extraites en France devrait être réutilisée, leur gestion nécessite de nouvelles pratiques opérationnelles.
Que deviendront les millions de mètres cubes de roches extraites du chantier du tunnel Lyon-Turin dans les dix prochaines années ? C'est la question à laquelle doit répondre la société TELT (Tunnel euralpin Lyon-Turin), l'opérateur public de ce projet de tunnel ferroviaire, le plus long au monde avec 57 km entre la France et l'Italie (pour un total de 164 km de galeries). L'ouvrage, annoncé pour 2033, est en cours de construction sous les Alpes. À ce jour, plus d'un quart des galeries ont été creusées.
Ce mois d'octobre, la société franco-italienne a inauguré la station de recyclage des roches excavées, opérée par un consortium emmené par Eurovia (Vinci), SATM Grand Travaux (Vicat) et Spie Batignolles avec des sociétés gérantes de carrières françaises, représentant un marché de 800 millions d'euros. Son objectif : trier les 24 millions de tonnes de matières excavées du tunnel côté français (sur 37 millions de tonnes au total sur les deux pays) dans les dix prochaines années et tenter d'en réutiliser au moins la moitié dans le cadre du projet.
Ainsi, environ 8 millions de tonnes devraient permettre de fabriquer des granulats, utilisés pour construire les voussoirs et les éléments en béton du futur ouvrage. 4 millions de tonnes iront également fournir du ballast pour les infrastructures ferroviaires de la vallée de la Maurienne.
De l'autre côté, une dizaine de tonnes seront évacuées vers des centres de stockage de la région être stockées comme des déchets inertes. Mais sur ce total, il restera 4 millions de tonnes de matériaux excédentaires, qui seront envoyés en train et en camions vers des sites extérieurs au projet.
Traverser plusieurs couches géologiques
Les quantités de matériaux seront immenses dans les prochaines années. Alors que le premier tunnelier est entré en service courant septembre, accélérant peu à peu le rythme de creusement, le pic des travaux est attendu pour la fin de l'année 2027. Jusqu'à 20.000 tonnes de roches seront extraites chaque jour sur les deux principaux points de chantier français. Un moment critique que TELT essaye d'anticiper, malgré des inconnues.
Le principal défi consiste à anticiper les types couches géologiques. Car malgré de nombreux sondages et carottages réalisés dans les années 1980, puis dans les années 2000, les ingénieurs ne connaissent pas avec exactitude la composition des roches. Chaque jour, un géologue alpin vient donc analyser visuellement le front de taille, dans la montagne : du calcaire, du quartz, des grès... « Il s’agit d'une étape de “préclassement” », expose Pascal Schriqui, rattaché à la direction construction de Telt, en charge de la gestion du chantier de gestion et de valorisation des matériaux d'excavation en France.
« Nous faisons la compilation entre l’analyse du géologue alpin chaque jour sur le front de taille, et les prévisions sur 30 ou 50 mètres grâce à des sondages. Plus ces matériaux seront caractérisés tôt, plus nous aurons une chance d’optimiser leur valorisation ».
20.000 tonnes de roches par jour au pic du chantier
Ce travail permet ensuite de diriger les roches vers le centre de tri d'Illaz. « Ce type d'usine a déjà été expérimenté dans le projet du tunnel de base du Saint-Gothard (Suisse, 57,1 km, inauguré en 2016), quasiment dans les mêmes configurations », ajoute Pascal Schriqui.
« Nous avons profité de l'expérience de l'entreprise suisse Marty - et le choix de ce groupement d'entreprises qui nous accompagnent - afin d'avoir la certitude que nous aurons des produits de qualité en sortie d'usine et dans le délai imparti. »
Mais à la différence du Saint-Gothard, les matériaux extraits du Lyon-Turin sont très variables. « On découvre la géologie exacte de la montagne au fur et à mesure de l'avancement du tunnel. Il y a des zones mixtes, avec plusieurs qualités de roches qui se mélangent. Dans ce cas, on doit reclasser ces lots en déchets, car nous ne savons pas les traiter avec ces débits ». Ces matières doivent donc être stockées.
« Cela cristallise les griefs sur le projet »
Ces déchets interrogent beaucoup la population, entre leur entreposage volumineux et leur répartition vers des carrières parfois sous tension. TELT reconnaît que la gestion des terres « cristallise la plupart des griefs sur le projet », car « il s'agit de la partie visible du chantier ».
L'opérateur franco-italien indique qu'une dizaine de sites « exutoires » sont disponibles dans la région, accessibles par camion ou par train. « Nous ne venons pas substituer totalement les capacités d'un site, qui sont bien supérieures aux besoins de TELT. Nos matériaux contribuent à améliorer leur remise en état et ainsi restituer ces sites à l'agriculture », soutient encore Pascal Schriqui.
Dans les prochaines années, d'autres chantiers pourraient également chercher des exutoires. Cela pourrait être le cas du CERN pour son futur collisionneur de particules, un projet d'anneau scientifique enterré d'une circonférence de 91km entre la France et la Suisse.
Un statut de « site unique » entre la France et l'Italie
Ce projet transfrontalier a également été confronté à un problème : les matières françaises traversant la frontière italienne étaient jusqu'alors considérées comme des déchets, même si elles étaient encore valorisables, et inversement.
Après plusieurs années de lobbying, « nous avons obtenu la validation de la notion de site unique et d'un protocole : lorsque nos matériaux franchissent la frontière, ils ne prennent plus automatiquement le statut de déchet, dans la mesure où ils sont utilisés dans l'ouvrage », explique Pascal Schriqui. « C'est une victoire, car cela va permettre de limiter le recours à un certain volume de matériaux extérieurs, mais aussi la mise en dépôts définitive de matériaux. »
Des granulats seront ainsi envoyés de l'Italie vers la France, déficitaire. Des matériaux de remblai vont quant à eux faire le chemin inverse. Au final, près de 1,5 million de tonnes de matériaux sera échangé entre les deux Etats européens.